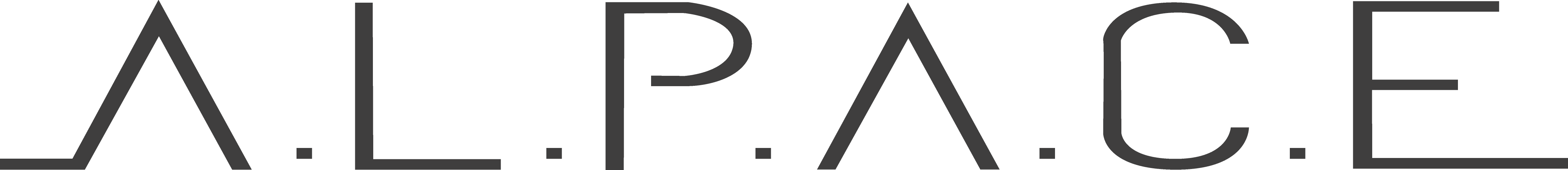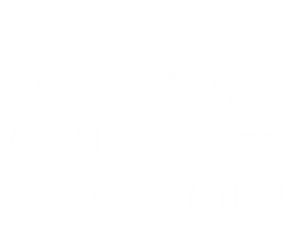Séminaires théorico-cliniques
Des séminaires théorico-cliniques, sur un weekend de 15 heures, sont proposés plusieurs fois
par an. Ces séminaires sont animés chaque fois par un intervenant extérieur.
Certains sont formateurs ou ont été formés à la Tavistock Clinic de Londres.
Les matins sont réservés à une communication-débat sur une thématique précise,
et les après-midis à des présentations de cas en lien avec la thématique.
LES PROCHAINS SÉMINAIRES
Thématique : De l’originalité du contact.
Argument :
Cette problématique se rejoue dans la vie de chacun, dans le soin, dans la pratique institutionnelle, dans le champ de la culture. Herbert Rosenfeld, Mélanie Klein, Salomon Resnik ; l’institut Loczy, l’haptonomie, Marcel Jousse ; Henri Maldiney, accompagneront nos réflexions.
Lieu : Vienne.
Vendredi 27 et samedi 28 septembre 2O24, séminaire avec Cristelle Lebon :
Thématique : Écouter le groupe familial, ses langages, ses souffrances, ses résonances.
Argument :
A partir d’une sensibilisation aux théories psychanalytiques du groupe spécifique qu’est la famille, à la croisée des liens d’alliance et de filiation, entre transmission, répétition et transformation, le groupe familial sera approché comme le lieu de problématiques complexes qui imprègnent et parfois envahissent les professionnels et les institutions. Nous serons particulièrement à l’écoute des modalités d’expression et de symbolisation des traces traumatiques, impliquant le registre de l’archaïque.
Cristelle Lebon est psychologue clinicienne et thérapeute familiale psychanalytique. Maitresse de conférences associée en psychopathologie et psychologie clinique et chercheuse associée à l’université Lumière Lyon 2. Formatrice pour l’ADTFA (Association pour le Développement de la Thérapie Familiale psychanalytique).
Lieu : Toulon.
Vendredi 22 et samedi 23 novembre 2O24, séminaire avec Éric Calamote :
Thématique: Les violences sexuelles dans l’enfance et l’adolescence. Impact et dynamique des expériences désastreuses.
Argument :
À partir d’une clinique issue de psychothérapies mais aussi d’exemples littéraires ou cinématographiques, ce séminaire étudiera la nature, les effets et les particularités des expériences traumatiques et plus particulièrement des violences sexuelles subies pendant l’enfance et l’adolescence. Sera soulignée l’importance des défenses paradoxales et du négatif pour un sujet tentant d’articuler une expérience désastreuse à l’ensemble de sa psyché, mais obligé en même temps pour cela de s’amputer de parts de son expérience ou de sa subjectivité, l’intrication constante du désastre et des ressources.
La confusion fréquente entre les aspects chauds et froids des expériences traumatiques, la paradoxalité, l’ambiguïté, l’intrication des scènes traumatiques questionneront la technique psychanalytique, les dispositifs et aménagements thérapeutiques nécessités (ou pas) par la rencontre avec de jeunes patients auteurs et/ou victimes de violences sexuelles.
Lieu : Vienne.
Programme
LES SÉMINAIRES PASSÉS
2O23 – Eric Calamote (Saint-Etienne) : « Les violences sexuelles dans l’enfance et l’adolescence. Impact et dynamique des expériences désastreuses ».
2O23 – Sylvie Reigner (Paris) : « Le corps vécu et fantasmé dans le lien transféro-contre-transférentiel ».
2O22 – Simonetta Adamo (Naples, Italie) : « Dispositifs à orientation psychanalytique dans différents milieux institutionnels : le Temps Spécial (interactions thérapeutiques avec enfants et adolescents) » et « Bref travail de soutien avec adolescents et jeunes adultes ».
2O22 – Jeanne Magagna (Londres) : « Le suicide et les automutilations » et « La thérapie auprès des jeunes personnes souffrant de troubles alimentaires ».
2O21 – Alain Ferrant (Lyon) : « Travail d’emprise et relations d’emprise ».
2O21 – Simonetta Adamo (Naples, Italie) : « Le jeu en psychothérapie ».
2O2O – Albert Ciccone (Vienne) : « La clinique des états-limites ».
2O2O – Évelyne Grange-Ségéral (Lyon) : « L’infantile dans la famille : traumatismes, fractures et résolution ».
2O19 – André Carel (Lyon) : « Le travail de causalité subjective » et « Le processus sacrificiel ».
2O19 – Florence Guignard (Suisse) : « Personnes et objets dans le lien thérapeutique. Rôle du deuil dans le développement personnel ».
2O19 – Didier Houzel (Caen) : « Les enveloppes psychiques. L’interprétation dans le travail auprès des enfants ».
2O18 – Albert Ciccone (Vienne) : « Aux fondements de la position clinique psychanalytique ».
2O18 – Florence Guignard (Suisse) : « La projection identificatoire du psychanalyste. Taches aveugles et interprétations-bouchons ».
2O17 – Régine Scelles (Paris) : « Subjectivation du handicap et processus de fraternité tout au long de la vie : le point de vue de l’enfant atteint ; le point de vue de ses frères et sœurs ».
2O16 – Rémy Puyuelo (Toulouse) : « L’adolescence, les inorganisations narcissiques précoces, la destructivité ».
2O16 – Pierre Delion (Lille) : « Le bébé, ses parents et leur souffrance psychique. Implications institutionnelles ».
2O15 – Odile Gaveriaux (Lorient, Londres) : « Troubles envahissants du développement et dépression primaire » et « Intérêts d’un dispositif d’observation dans le travail clinique ».
2O14 – Asha Phillips (Londres) : « Les troubles alimentaires chez le bébé » et « Application de la formation psychothérapeutique à l’institution : exemple d’une institution scolaire ».
2O14 – André Carel (Lyon) : « L’expérience de catastrophe dans l’histoire générationnelle et ses réminiscences dans les liens premiers. La trilogie défensive qu’elles peuvent générer dans la psyché singulière et dans l’appareil groupal-familial : paradoxalité, perversion narcissique, incestualité ».
2O13 – Simone Korff-Sausse (Paris) : « Approche psychanalytique du handicap » et « La vie psychique du bébé selon Mélanie Klein ».
2O13 – Salomon Resnik (Venise, Paris) : « Psychanalyse et psychose ».
2O12 – Didier Houzel (Caen) : « Psychoses, états-limites. La pensée de Donald Meltzer ».
2O12 – José-Luis Goyena (Paris, Londres) : « La pensée de Wilfred Bion ».
2O11 – Asha Phillips (Londres) : « Le jeu chez l’enfant ».
2OO9 – Didier Houzel (Caen) : « Autisme. La pensée de Frances Tustin ».
2OO9 – Dominique Thouret (Lyon) : « La pensée clinique de Herbert Rosenfeld, Henri Maldiney et Salomon Resnik (suite) ».
2OO8 – José-Luis Goyena (Paris, Londres) : « La pensée de Wilfred Bion ».
2OO8 – Alain Ferrant (Lyon) : « Freud et la dynamique du transfert » et « Transfert et contre-transfert ».
2OO8 – Dominique Thouret (Lyon) : « La pensée clinique de Herbert Rosenfeld, Henri Maldiney et Salomon Resnik ».